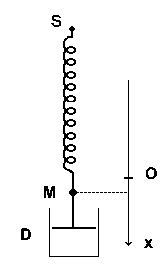A
température ambiante :
Le Chlore est
sous forme d’un gaz vert, le dichlore.
Le Brome est
sous forme d’un gaz orange, le dibrome.
L’Iode est
sous forme d’un gaz violet : le diiode.
On a versé 2 mL de solution aqueuse de dichlore, de
dibrome et de diiode dans ces trois tubes à essais.
Expérience avec le cyclohexane:
Dans chaque
tube, nous avons ajouté environ 1 mL de cyclohexane.
Sur le
flacon de cyclohexane, on a vu ce pictogramme :
Il signifie qu’il y a un danger d’incendie. Il faut le tenir
éloigner d’une flamme, d’une étincelle, de chaleur, d’électricité statique.
En l’ajoutant, on remarque que chaque tube contient deux
phases de liquide qui ne sont pas miscibles .Le liquide le plus léger est au-dessus
c’est le cyclohexane.
On obtient les couleurs suivantes :
-
Dans
le premier tube d’eau chlorée : vert et transparent
-
Dans
le second tube d’eau bromée : orange et jaune-vert
-
Dans
le troisième tube d’eau iodée : violet et orange.
On remarque que plus on agite les tubes, plus les couleurs
deviennent intenses en haut et faibles en bas.
Cela signifie que le chlore, l’iode et le brome passe de la phase
liquide du bas vers celle du haut.
Expérience avec le nitrate d'argent:
Nous avons ainsi préparé 3 tubes a essais contenant 2 ml de
solution de :
- Chlorure de potassium
- bromure de potassium
- et de d’iodure de potassium.
Ensuite dans chaque tube, nous avons introduit quelques
gouttes de solution aqueuse de nitrate d’argent.
Après avoir mis les quelques gouttes de nitrate d’argent, on
observe que les deux solutions présentent un précipité blanchâtre.
Ils deviennent solides, tous les solides se déposent en bas
des tubes a essaie.
-Le chlorure de potassium devient blanc.
-Le bromure de potassium devient aussi blanc.
-L’iodure de potassium devient plus jaune vert en revanche.
Conclusion :
Les trois éléments étudiés montrent des similitudes dans leur réactivité chimique; ils font partis de la famille des halogènes.